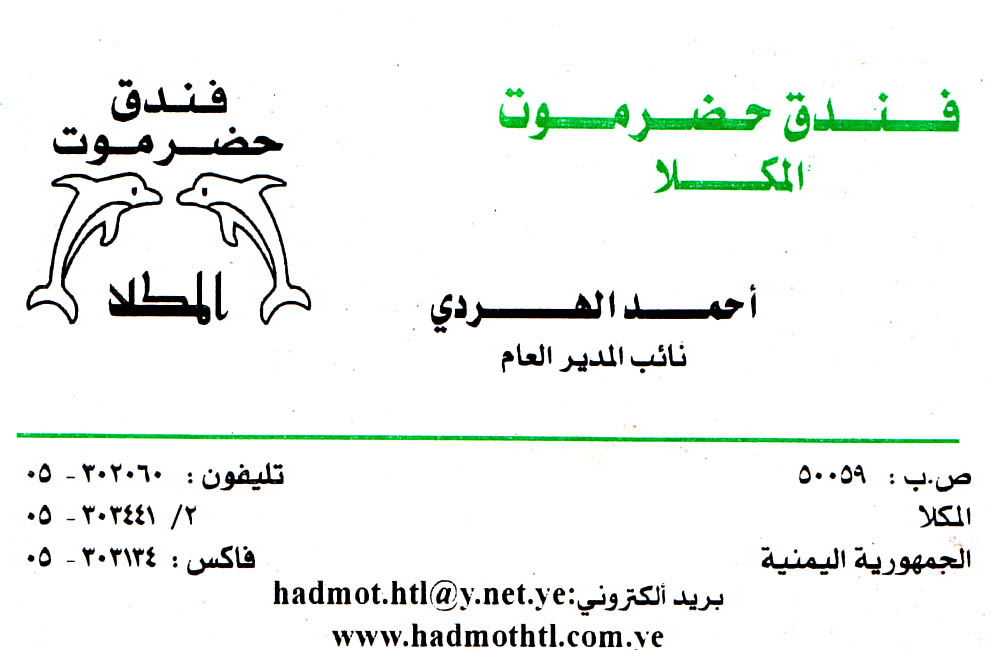RETOUR AU YEMEN
DU 5 AU 18 JUILLET 2004

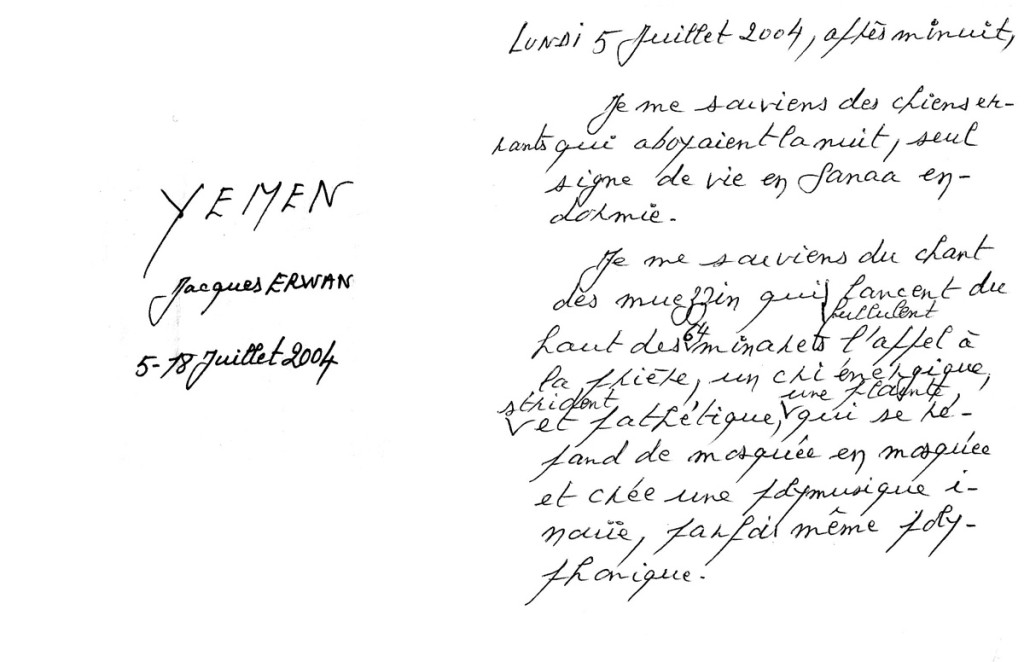
TRADITIONS !
LUNDI 5 JUILLET, au cours de la nuit avancée…
SANAA, POLYPHONIE
Je me souviens.
Seize ans déjà !
Je me souviens des chiens errants qui aboyaient la nuit, seul signe de vie en Sanaa endormie.
Je me souviens du chant des muezzin qui, aux heures pâles de la nuit, ululaient du haut des soixante-quatre minarets disséminés dans la ville l’appel à la prière. Un appel ? Un cri énergique, strident et pathétique. Comme une plainte soutenue qui se répand de mosquée en mosquée et crée dans l’espace, au fil des minutes, une musique inouïe, une polyphonie digne d’éveiller les âmes.
Je me souviens.
MARDI 6 JUILLET
SANAA, DIEU EST GRAND ET…MULTIPLE
Embouteillages et tohu-bohu; comme beaucoup de villes dans le tiers-monde, Sanaa est encombrée d’une pléthore de voitures et de motos qui pétaradent en tous sens et soulèvent un voile de poussière. Le concert d’avertisseurs s’interrompt quand retentit l’appel à la prière, « Allah Akbar »… Dieu est grand… proclame le muezzin.
Environ la moitié des Yéménites est chaféite, l’un des quatre principaux courants du sunnisme, la branche « orthodoxe » de l’Islam à laquelle appartiennent 90% des musulmans dans le monde. Le fondateur du chaféisme est mort au IX° siècle. Son enseignement s’est répandu dans toute la péninsule arabique et sur la côte est de l’Afrique. Un siècle après sa mort, ses préceptes gagnent l’Hadramawt puis, le sud du pays. Les villes de Tarim et Zabid deviennent des hauts lieux du chaféisme. Depuis le IX° siècle, l’autre moitié des Yéménites est zaydite, une branche du chiisme. Zélateurs d’un régime d’imamat, les adeptes de ce courant se maintinrent au pouvoir, dans le nord du Yémen, jusqu’à la révolution de 1962.
Une minorité, ismaélienne, appartient, depuis le XI° siècle, à un autre courant du chiisme. Les Ismaéliens demeurent assez secrets, mais sont ouverts à l’interprétation du Coran, à l’exégèse.
QATE OU QUITTE…
Rue du 26 septembre, une gargote abrite le premier déjeuner partagé avec R., mon voisin de chambre: savoureux poulet grillé garni d’un assortiment de carottes, pommes de terre et riz et arrosé de thé parfumé. Le prix n’atteint pas celui d’une médiocre mise en bouche dans un bistrot parisien… R.,29 ans, a étudié la gestion, l’arabe, l’hébreu et l’araméen ainsi que le Droit musulman. Il entame des recherches relatives aux fonds de placement arabes… Ce garçon est une mine !
C’est l’heure du qat. Une plante au cœur de l’économie du pays, objet d’un rituel social et d’un moment de convivialité. Le qat est un arbuste qui mesure de trois à sept mètres de haut. Ses plus jeunes feuilles, riches d’une substance narcotique, suscitent, lorsqu’elles sont mâchées, une certaine euphorie. Son commerce représente un tiers de l’activité économique du pays. Chaque après-midi, à l’occasion de ce rituel, la vie s’arrête. La plupart des Yéménites « broute » le qat, le plus souvent au dernier étage de la maison traditionnelle, le mafraj. On y convie amis et relations et, au fil des heures, conversations et négociations diverses déroulent leurs méandres. Poésie et musique, parfois, s’y invitent également. Voire, le « regard intérieur » de la méditation. Ainsi dans le mafraj d’un établissement français de Sanaa, un commerçant de Bayt El Faqih, ville de la province de la Tihama que borde la mer Rouge, qate avec son directeur. A. est là. C’est un personnage puissant et haut en couleurs : fou de poésie et de musique, il ne dédaigne pas l’argent. Avide, le mot flouz (argent) émaille son propos…
La journée s’achève paisiblement dans la torpeur ambiante.
MERCREDI 7 JUILLET
SANAA, EN AVANT LA MUSIQUE !
En ville, comme chaque jour, le tohu-bohu est général et les embouteillages paralysent la cité. L’après-midi, Jean, savant ethnomusicologue, offre une conférence. Il partage ses connaissances relatives à la musique yéménite. Celle-ci, comme il est d’usage, se perpétue et se transmet par voie de tradition orale.
Sur les hauts plateaux, à chacun la sienne : les citadins (marchands, lettrés…) développent une musique originale, les ruraux (hommes des tribus et paysans) une autre. L’identité citadine s’est construite en opposition aux tribus.
À la campagne, les chants de travail conservent leur vitalité. À chaque activité correspond un type de chant : culture du sorgho, labours, semailles, récoltes… Les chants des hommes des tribus, des paysans, défendent une éthique de l’honneur, des valeurs guerrières. Ils célèbrent la tribu, autorisent le dialogue entre ses membres par le truchement de la poésie et de la musique… La musique vocale des tribus et des paysans est associée à une fonction précise et l’aspect musical est secondaire.
La musique de divertissement -les chansons d’amour- est considérée comme dangereuse parce qu’elle émousse les valeurs guerrières. Cette musique est l’apanage d’une caste spécialisée dont les membres jouent du mizmar », une clarinette double, et des percussions pour rythmer la danse. Quant aux femmes, elles dansent en un lieu distinct sous la conduite d’un orchestre féminin. Il est composé de voix et de percussions car, un tabou frappe tout instrument mélodique.
En ville, on est fier d’être citadin. On joue du ûd, ce luth à cinq cordes arrivé au Yémen voici quelques décennies. À Sanaa, autrefois, prévalait un luth à quatre cordes. Creusé en une seule pièce dans un bloc de bois, il était recouvert d’une peau tannée à l’oxyde de cuivre. On en jouait avec une plume d’aigle. C’était l’instrument de prédilection des classes supérieures. Porteur d’une musique « classique », noble et précieuse, il accompagnait une poésie sophistiquée dans l’écrin du mafraj , l’après-midi, tandis que l’on mâchait le qat. Quelques rares musiciens en perpétuent l’art. Quant au mizmar , seules les classes inférieures l’acceptent.
En milieu urbain, la pratique religieuse suscitait une prévention à l’encontre du ûd et nombre d’imams zaydites en combattirent l’usage. Ceux qui en jouaient, proches de l’imam, se prétendaient simples amateurs et n’apparaissaient guère en public. Ils se faisaient entendre dans le cadre des salons privés. Comme à la campagne, et pour les mêmes raisons, les femmes chantent en s’accompagnant de percussions.
JEUDI 8 JUILLET
SANAA – BAYT EL FAQIH, SOMMETS
Ce jeudi 8 juillet, départ pour Bayt El Faqih à 6 heures. L’ineffable A. fait partie du voyage et, d’emblée, antienne récurrente, parle d’argent…
La route dévale des pentes vertigineuses, gravit des côtes pentues et plonge à nouveau vers la descente… Au fil de certains virages, des paysages de montagne, d’une beauté grandiose, se succèdent. Les sommets escarpés soutiennent le voile bleu du ciel. Des villages s’y accrochent ; ils défient les lois de l’équilibre. Les maisons, construites en pierre, ressemblent à des tours. Austère et orgueilleuse, cette architecture témoigne de la fierté des hommes.
D’innombrables marchés émaillent le parcours. C’est jeudi, le jour du souk : chèvres, veaux, pommes et bananes… pêle- mêle, composent un indescriptible désordre qu’accompagnent le vacarme des moteurs, les cris des animaux, la stridence des appels et la rumeur des conversations. Des hommes des tribus, mitraillette en bandoulière, marchent comme à la parade. On dit qu’il y aurait, au Yémen, 60 millions d’armes. En fait, il semble que le chiffre fiable s’élève à 12 millions pour environ 16 millions d’habitants (recensement 1994).
Chargés d’hommes, portant futa, à la manière traditionnelle, ou de veaux, camions et camionnettes roulent à grande vitesse sur ces routes vertigineuses. Il arrive que des accidents spectaculaires endeuillent la circulation. Certains véhicules convoient des femmes tout de noir vêtues, voile au vent. La majorité des femmes yéménites, en effet, est voilée. Mais, ces femmes sans visage ont des yeux. Et, quand un homme les croise, elles dardent un regard ardent de leurs yeux de braise.
Au fil de la descente, la montagne s’émousse et se découvre la plaine. À la végétation verdoyante se substituent des étendues de terre sablonneuse, piquées de quelques rares dunes. Elles sont creusées par les labours et plantées de bananeraies et de vergers. Dans les vallées comme dans la plaine paissent troupeaux de chèvres et de moutons, parfois quelques vaches étiques, gardées par des pâtres impubères ou de vieux bergers chenus. Le monde semble figé en un temps lointain : ici, autrefois, c’est aujourd’hui.
Bab Al Naga, porte du chameau, s’ouvre comme une porte de pierre percée dans le flanc de la montagne : elle marque la séparation entre les hauts plateaux et la plaine. À la fraîcheur que prodigue l’altitude succède une chaleur épaisse, humide et suffocante. On dit qu’un Tihamite*, condamné à l’enfer, se réjouirait d’y trouver un peu de fraîcheur…
*Originaire de la province de la Tihama, qui borde la Mer Rouge.
SALE !
Depuis 8 heures, le chauffeur mastique ; il a devancé l’appel du qat et A. crache à profusion, fouille les profondeurs de ses narines, s’égare dans le labyrinthe de ses oreilles… Je transpire en attendant des heures plus sereines.
Au terme de cinq heures de route, les huttes des campagnes de la Tihama s’effacent et surgissent les édifices en béton de Beyt Al Faqih. Des chemins défoncés, jonchés de détritus, conduisent à la maison d’A. nichée dans une venelle. Un vieux fort ottoman abandonné veille sur cette ville devenue un immense dépotoir à ciel ouvert: collections de pneus usagés, tas de ferraille, immondices divers et sacs plastiques gris par milliers. Certains accrochés aux branches d’arbres comme autant d’improbables feuilles mortes. Certaines odeurs agressent le chaland tels les effluves nauséabonds de ces peaux de mouton qui sèchent au soleil auprès d’une tannerie. La ville est sale.
La maison d’A. baigne dans une semi – obscurité ; elle suinte l’humidité. L’intérieur est négligé. À l’étage, le salon, pourvu d’un climatiseur, est éclairé par des vitraux modernes, aux couleurs vives, et des rosaces dont plusieurs carreaux sont cassés et laissent pénétrer l’air chaud et humide. Les rideaux sont en partie décrochés. Les tapis, divans et coussins offrent un aspect douteux… Le ménage n’appartient pas au quotidien. Le poste de télévision est juché sur une table roulante… roulettes en l’air car son plateau est cassé. Un buffet quelconque, deux ou trois tables basses en verre, maculées, complètent le décor.
À droite et à gauche, des terrasses extérieures jouxtent cette pièce. Elles sont encombrées de gravats et de ferraille qui ne dissuadent pas les voisins d’y converser bruyamment le soir…
À côté du salon, un réduit sombre et crasseux abrite les toilettes à la turque -mais ce n’est pas un rondo- souvenir sans doute de la présence ottomane, et le mince filet d’eau d’une douche. Sous les fenêtres, une cabane, coiffée d’un toit de tôle rouillée est le logis où survit un pauvre hère.
Repos dans la moiteur du salon qu’atténue à peine le souffle du climatiseur et du ventilateur. L’encens se consume et inonde la pièce de ses senteurs.
La ronde des mouchoirs en papier caresse les fronts et éponge la sueur qui ruisselle… Une nuée d’enfants court en tous sens, pleure, crie, hurle. À l’extérieur, les motos pétaradent à l’envi et les avertisseurs s’affolent. La chaleur et le bruit épuisent. Seul l’appel à la prière, lancé par le muezzin réjouit l’oreille et apaise l’âme.
MANGER…
Aux alentours de 13 heures, on s’achemine lentement vers l’étage inférieur. La pièce est flanquée de hautes banquettes, mais l’on s’assoit à même le sol ou bien sur des coussins. Tous les membres de sexe masculin de la famille – A., ses fils et petits- fils- sont réunis autour de feuilles de papier d’emballage sur lesquelles on dépose des plats, puis les reliefs du repas. C’est un déjeuner sur l’herbe, dont l’herbe s’est absentée, fort pittoresque. Chacun, sauf l’invité, gratifié d’une cuillère, plonge la main droite, la gauche est réputée impure, dans les plats pour saisir la nourriture. Sur un rythme enlevé, la farandole des mains prélève les morceaux d’agneau et de poulet, le riz et les macaronis, le pain. Chacun mange vite, avec gourmandise et sensualité. Pommes et oranges, concluent ce repas arrosé d’eau et de thé. On rote et on rend grâce à Dieu…
…ET QATER
Le repas n’est pas un moment privilégié de convivialité. La séance de qat qui lui succède, et occupe toute l’après-midi, répond à cette fonction.
14 heures 30, au Forum, lieu culturel de la cité, je m’enfonce dans la profondeur d’un divan, coudes appuyés sur le moelleux des coussins. Les pales de deux puissants ventilateurs brassent l’air humide. Au fil de longues minutes -respirer est un effort- musiciens et danseurs convoqués arrivent les uns après les autres et prennent place. Ils appartiennent à diverses générations, mais tous portent vêtements et coiffure traditionnels.
A. donne des instructions, râle, ordonne, crie, hurle… Chacun lui obéit. On le salue avec déférence, on l’embrasse avec affection.
Notable culturel local, tantôt débonnaire, tantôt tyrannique, il règne sur ce petit monde de courtisans.
C’est l’heure! Tout le monde qate, y compris l’un des jeunes petits-fils d’A., qui n’a pas encore gagné l’horizon de l’adolescence. Deux salons s’organisent, côte à côte : l’un réunit une vingtaine de personnes, l’autre, une douzaine. L’atmosphère est lourde, chargée d’humidité. Dans la moiteur ambiante, chaque geste se dessine avec langueur, chaque mot s’envole lentement. L’eau circule de lèvres en lèvres: il faut boire car le corps se déshydrate. Le temps passe, rien ne se passe: les paroles succèdent aux paroles et la musique est absente… Deux heures plus tard, un jeune homme pince les cordes de son ûd et chante… Le forum est comble maintenant: feuilles et rameaux de qat rejetés jonchent la mosaïque du sol ainsi que les mégots des cigarettes et les mouchoirs en papier usagés. Chacun est nanti de son sachet de qat et mastique avec application et opiniâtreté. Il nourrit ainsi une chique collée dans la joue droite qui grossit au fil des heures. Des jeunes gens alanguis, tels des odalisques, poignard traditionnel fiché dans la ceinture, comme protégeant le sexe, trient les fines feuilles du qat. Ils les glissent avec des gestes délicats entre leurs lèvres. Petit doigt levé, comme Anglaises à l’heure du thé, ils se désaltèrent d’un verre d’eau. Certains, jeunes ou plus âgés, ornent leur chevelure de jais d’un brin de jasmin blanc planté dans leur turban. Un crachoir de métal recueille les salves de jets de salive verdâtres qu’entraîne la mastication de ces feuilles. Grâce et virilité vont de pair.
Dans un angle de la pièce, l’encens brûle et diffuse son parfum. On apporte de hautes pipes à eau indiennes dont la structure en verre s’acoquine à une protection de métal ciselé. Elles se prolongent par une longue et fine trompe; celle-ci est munie d’un embout de cuivre qui passe de bouche en bouche, à peine essuyé d’un geste furtif de la main. Des odeurs de tabac d’orient se mêlent à celles des fumées de cigarettes qui se consument dans les bouches déformées par la chique de qat. L’atmosphère moite s’alourdit; chacun cède à l’indolence, voire succombe à la torpeur.
Les musiciens se succèdent, porteurs de styles divers, de ce jeune joueur de ûd à ce vieux maître borgne tout de blanc vêtu.**
Ainsi s’écoule le temps tandis que les fronts s’emperlent et que les corps s’épuisent. L’écoute se prolonge jusqu’à environ 19 heures 30.
**En ce qui concerne la musique de cette région, voir plus loin l’article de Jean Lambert et Abdallah Khadem al-Umari, intitulé « Chants de la Tihama », in Journal du Théâtre de la Ville, avril – mai – juin 2006.
C’est l’heure de la deuxième coupure d’électricité de la journée. Épuisé, je réintègre, dans les ténèbres, le foyer de A. C’est ainsi, Inch Allah! Et chacun semble s’en accommoder puisque Dieu le veut. Eau, jus de fruit et bananes composent mon seul viatique. Faute d’électricité, point de climatisation. La température du salon atteint un seuil insupportable. Hospitalité limitée chez cet Harpagon oriental: pas un drap, pas une serviette… L’atmosphère est irrespirable. On suffoque. Panique! On s’allonge, presque nu, sur un fin matelas, sale, posé à même le sol, un linge humide étendu sur le front… Ne pas bouger: pas un geste. Pas même pour regarder l’heure… Les secondes sont des heures. Ne pas penser : vacuité de l’esprit. Attendre.
Trois heures plus tard, l’électricité est de retour; elle alimente à nouveau le climatiseur. La vie renaît, les feuilles humides de mon carnet de notes sèchent… Les bruits de la ville s’atténuent, s’apaisent puis, s’évanouissent. Sommeil.












VENDREDI 9 JUILLET
BAYT EL FAQIH, DANSES ET SOUK
À 6 heures du matin, le soleil est déjà hostile. L’électricité est de nouveau absente. Inondé de sueur, privé de douche et dépourvu de serviette, je me dégoûte…
Deux heures plus tard, à l’orée des champs de céréales, démonstration de danse: une douzaine de danseurs, vêtus de blanc, escortés par cinq musiciens: une flûte et quatre tambours. Certaines de ces danses, acrobatiques, exigent agilité, adresse et maîtrise de l’esquive: hamra , un poignard passe et repasse entre les jambes du danseur ou mobayana, joute entre un danseur armé de deux sabres et un tambour muni de deux baguettes.
Le marché de Bayt El Faqih, village fondé, dit-on, au XIII° siècle, existe depuis le début du XVIII°. Situé au centre de la province de la Tihama, c’était un carrefour marchand idéal entre plantations de café nichées dans les montagnes et ports ouverts sur le monde. Le commerce du moka a fait connaître la ville des amateurs de café arabe du monde entier.
Aujourd’hui, c’est un immense souk composé d’allées à ciel ouvert et d’autres couvertes. Il est divisé en divers marchés selon la nature des marchandises offertes. Les produits agricoles et artisanaux de la région abondent : chameaux, vaches, ânes, agneaux, chèvres, poulets… mais aussi, poteries, vêtements colorés, paniers… De café, point. On y trouve aussi du fourrage, de l’avoine, du bois de construction, des épices, des légumes et des fruits, du poisson, du tabac et, bien sûr, les précieuses feuilles de qat sans lesquelles, un homme au Yémen est comme eunuque au harem. Les maquignons s’affairent, les chalands marchandent et les marchands négocient. La richesse de ce marché contraste avec la pauvreté apparente des autochtones.
Réflexions relatives à cette ville :
Il faudrait :
- Un bulldozer pour déblayer les détritus et creuser à nouveau les chemins de terre,
- Une noria de camions pour enlever les montagnes d’immondices qui défigurent la cité et polluent,
- Des litres de chaux pour blanchir extérieur et intérieur des demeures,
- Une pléthore de poubelles,
surtout, une pédagogie de l’hygiène et de la propreté ainsi qu’un planning familial. Ce dernier pour enrayer la progression du taux de fécondité, élevé si on en juge par la myriade d’enfants qui pullulent au cœur de ce gros bourg.
ZABID, LA VENERABLE
Au cours de la matinée, on se dirige vers le sud : Zabid se situe à 37 kilomètres. Cette cité, l’une des plus anciennes du pays, existait dès le IX° siècle ; son université rayonnait dans le monde musulman. Aujourd’hui, le taux d’analphabétisme est élevé : de 70 à 80 % de la population.
On affirme qu’entre le XIII° et le XV° siècle, l’université de Zabid comptait quelque 5000 étudiants. Ces élèves fréquentaient plus de 200 écoles et mosquées. Elles dispensaient divers enseignements. De nos jours, la ville compte encore 86 mosquées (on croit l’autochtone sur parole). Elle recèle aussi quelques beaux quartiers à l’intérieur de l’enceinte de ces remparts percés de portes anciennes. Apparemment plus propre que sa voisine Bayt El Faqih, elle souffre –-si l’on en croit la rumeur- d’être l’une des plus chaudes du pays.
Las et sale, on relâche au Zabid Tourist Rest House pour se détendre et s’abreuver. Hélas! La seule chambre pourvue de l’air conditionné est occupée… Point de répit, donc, bien que la chaleur impose au corps sa loi.
En quête de Mohamed Al Yaami, nous le repérons juché à l’arrière d’une moto, sous l’une des anciennes portes ottomanes qui percent les remparts. Elle abrite le local de l’association qu’il anime. L’après -midi, femmes, enfants et quelques hommes y présentent chants, musiques et danses. Quatre femmes noires d’abord. Descendantes, nous dit-on, d’anciens esclaves, ces femmes ne voilent pas leur beau visage. Leur chevelure est retenue par un fin turban d’un agencement complexe. Elles portent une robe noire, ornée, sur la poitrine d’un large motif argenté. Bras et mains sont décorés de dessins tracés au henné. Chacune d’elles frappe l’embouchure d’une jarre et bat des mains; ainsi rythment-elles un chant indolent et lancinant, ponctué de « youyous ». Deux tambours à deux faces, battues à la main, les accompagnent ainsi qu’un petit tambour rond que font sonner deux baguettes. Un danseur offre, ensuite, une spectaculaire danse du sabre. Dehors, le tohu-bohu des motos, le vacarme des klaxons et le chahut d’une foule d’enfants rappellent avec insistance que la vie suit son cours.
La gasba , flûte aux sonorités aiguës et les voix des femmes, interprètent une courte pièce, rythmée par les tambours et les battements de mains. Gasba et tambours escortent, ensuite, les danseuses : elles sautillent d’avant en arrière. Suit l’ agfa qu’exécutent six femmes et trois hommes, accroupis, genoux pliés. Deux garçonnets très agiles se livrent, à tour de rôle, à la danse du poignard. Une joute oppose deux sabres à deux baguettes (« mobayana »).
À l’extérieur du local, six femmes forment une chaîne; elles sautillent sur un pied et tournent de gauche à droite. Sur le rythme d’un tambour, elles martèlent le sol. Deux jeunes garçons s’affrontent en faisant de même, les deux mains tenues par celles d’une femme… c’est superbe!
SUR LA ROUTE DU RETOUR
La route du retour traverse un paysage de plaine fertile : cultivée, elle est irriguée par l’eau qui descend des sommets. Après Bab el Naga, à mi-route, commence l’ascension de la montagne. Avec l’altitude, la température devient plus clémente et l’on retrouve le plaisir de respirer à pleins poumons. En fin d’après-midi, le soleil commence à décliner lentement. Sillonnée de poids lourds dans les deux sens, cette route est dangereuse; d’autant que la conduite est nerveuse. Il est permis d’avoir peur.
Des terrasses assaillent les pentes verdoyantes plantées de maigres arbustes. Au pied des montagnes, les vallées, fertiles, sont cultivées. Les sillons des labours strient la terre et composent un tableau géométrique. Des troupeaux paissent. Les chèvres s’acharnent et arrachent les feuilles des arbustes.
Le disque rouge du soleil sombre derrière les crêtes et disparaît. Le couchant dissout les aspérités du relief et les contours du paysage s’évanouissent, masqués par ce voile léger qui précède la nuit.
De nuit, la route est une pire épreuve : nombre de véhicules sont peu ou mal éclairés. Enténébrées, les montagnes s’éclairent, ici ou là, de frises de couleurs que composent ces lumières diffusées par les vitraux des hautes demeures de pierre.
L’arrivée à Sanaa sonne l’heure du retour à un certain confort…
SAMEDI 10 JUILLET
SANAA, UNE LECON, UN CONCERT
Au coin de la rue, un marchand à la sauvette propose des figues de barbarie, suaves barbares, qu’il épluche avec dextérité sous les yeux du chaland.
REPERES
- octobre 1963: début de la lutte armée contre la Grande-Bretagne à Aden (au sud du Yémen).
- 30 Novembre 1967: Indépendance du Yémen du Sud. Création de la République Démocratique et Populaire du Yémen.
- 1978: au nord, avènement du président Saleh.
- 1986: luttes fratricides à Aden (RDPY).
- 1990: union des deux Yémen.
- 1994: tentative de sécession du sud (guerre) qui méprise les nordistes, frustres « bouffeurs de qat », fascinés par les armes.
En fin d’après-midi, une conférence d’un jeune doctorant en sciences politiques évoque « la situation politique au Yémen après le 11 septembre 2001 ». Il rappelle que l’union des deux Yémen (nord et sud) en 1990, n’a pas été correctement préparée. Les deux entités développaient deux politiques différentes : au sud, par exemple, les femmes jouaient un rôle important, les terres étaient nationalisées et la place des tribus réduite.
En août 1990, le Yémen refuse de s’associer à l’ultimatum adressé à l’Irak et à l’embargo. Le pays est mis au ban des nations. En septembre, 800 000 travailleurs yéménites sont expulsés d’Arabie Saoudite. De ce fait, la population augmente de 10% et la population active de 30% .
Dans l’euphorie qui succède à l’unification, les partis politiques, comme les titres de Presse (de qualité inégale) se multiplient.
Les élections législatives sont un exemple pour la région. Une réelle liberté d’expression existe. L’expérience démocratique inspire les chercheurs occidentaux.
Le nombre de partis politiques diminue…
La tendance autoritaire du pouvoir s’affirme. Le chef de l’État, le président Saleh, est au pouvoir depuis 26 ans.
Le 11 septembre, conclue le chercheur, instaure un nouvel équilibre:
- Les tribus sont progressivement expulsées du système politique au profit d’une centralisation du pouvoir,
- La tolérance à l’égard des islamistes a vécu, le pays coopère avec les États- Unis mais,
- Il maintient la rhétorique anti-américaine et panarabe.
Le soir de ce même jour, concert : une belle salle ronde et bleue de sept mille places. Presque deux heures de patience; les travées supérieures se remplissent : nombreuses femmes sans visage, vêtues de noir, et beaucoup de jeunes portant l’habit traditionnel, d’autres en jeans. Le parterre accueille des hommes, hommes poignard( fiché sur le bas-ventre), hommes complet veston, hommes vêtement de sport… Ce concert s’inscrit dans le cadre des manifestations « Sanaa capitale culturelle arabe 2004 ». Arrivent les officiels : délégations des pays du Golfe, ambassadeurs, dont celui d’Arabie Saoudite… hué par le public! En général, les concerts sont gratuits, mais, ce soir, le carton d’invitation est exigé à l’entrée. Soudain, un flot de jeunes envahit les gradins : pour remplir la salle, sans doute a-t-on ouvert les vannes.
Enfin, Il arrive. Chanteur adulé dans les pays du Golfe, Abou Bakr Salam Bal Fakri est très entouré : entre autres par le ministre de la culture du Yémen, fils d’un sheikh et poète. Petit et corpulent, l’artiste, acclamé par le public, salue les deux bras levés. Bref discours du ministre, remise d’une guirlande de jasmin… Ce protocole, dit un expert, revêt un caractère politique : le chanteur est originaire de l’Hadramawt, une province éloignée de l’est. Nombre de ses habitants ont émigré en Malaisie et en divers pays d’Asie où ils ont fait fortune. Cette soirée est une affirmation de l’unité du Yémen et un appel du pied aux capitaux de ces riches émigrés.
C’est le ballet du Yémén qui ouvre la soirée : danses traditionnelles, hélas folklorisées et chorégraphiées, exécutées par un ensemble de danseurs et de danseuses. Etonnant, elles sont pour la plupart blondes aux yeux bleus ! En fait, épouses de Yéménites, elles sont russes, ukrainiennes, biélorusses… souvenirs de la République Démocratique et Populaire d’Aden… L’interprétation chorégraphique est ridicule !
Suit un poète de l’Hadramawt, courtisan et pesant : il déclame un poème composé à partir des lettres du nom du chanteur…
Les musiciens, invités à gagner la scène, se font prier et arrivent dans le plus grand désordre, instruments à l’abri des étuis… Vingt-cinq musiciens ! C’est l’orchestre « oriental » : dix violons, cinq percussions, deux violoncelles, un ûd, un kanoun, une basse incongrue et l’inévitable synthétiseur. Sans oublier le chœur, composé de quatre femmes, assises au fond, derrière l’orchestre, et donc invisibles !
Enfin, le petit homme fait son entrée : nouvelles acclamations. Il interprète des chansons de l’Hadramawt alourdies par les orchestrations et le sirop des violons. Ne dit-on pas : le violon est à la musique orientale ce que le miel est à la pâtisserie. Une chanson de ce répertoire fait exception ; ancienne, elle est fort belle. Une autre empruntée à celui de Sanaa, en revanche, n’est guère réussie ? Mais, vive l’unité du pays, n’est-ce pas ? Le public exulte. Certains jeunes dansent. L’ambiance est à la joie. Un rien suscite la ferveur, l’exaltation, la frénésie.
L’orchestre joue correctement, mais on déplore ses accents sucrés et, à l’occasion, les martèlements frénétiques du synthétiseur. La voix est magnifique. Dans le registre grave, elle souffre la comparaison avec le timbre de ces barytons russes. Ductile, elle s’élève des aigus aux graves et va et vient ainsi d’un registre à l’autre, témoignant d’une agilité remarquable au fil de ces acrobaties vocales. On regrette d’autant plus qu’Abou Bakr ait abandonné le dépouillement musical qui magnifiait ses débuts dans les années 50.
Ce soir, la star semble fatiguée. Le chanteur s’assoit entre chaque chanson. Plus tard, il sera victime d’un léger malaise. À 23 heures 30, la messe est dite. Juste le temps de gagner l’une de ces gargotes qu’apprécient les noctambules adenis : œufs brouillés, délicieuse galette, que l’on se partage comme le pain, et thé parfumé. Il est une heure et des étoiles à Sanaa. Les chiens aboient dans le silence de la nuit et sous le sourire de la lune.
DIMANCHE 11 JUILLET
SANAA, TRADITIONS
Un petit théâtre accueille « la semaine de l’Hadramawat » : caméras en nombre, peu de spectateurs. C’est le fief du folklore, ce musée des traditions figées… Brève apparition de Saïd Abdel Naïm, chanteur et musicien âgé de quatre – vingt dix ans ; la voix de la flûte gasba et les rythmes, frappés sur un tambour et des percussions, l’accompagnent.
À la mi-journée, visite du Centre de Musique qu’abrite la bibliothèque. Sa mission est d’assurer la protection du patrimoine oral du Yémen. Un trésor ! Vaste entreprise pour éviter que l’humanité ne perde la mémoire.
Ecoute de quelques-uns des enregistrements réalisés par J., ethnomusicologue français, au cours des années 80, illustrés de ses commentaires. Les chants de travail subsistent, apprend-t-on ainsi. Ils témoignent de la fonction sociale de la musique traditionnelle et sont le miroir de la pâte épaisse du réel. Un chant évoque le travail dans les plantations de café -certaines existent encore- : « envoyez le grain à l’étranger, gardez l’écorce pour nous ». Il en est un autre qui rythmait la coupe des récoltes. D’une tonalité aigüe, un chant est interprété par les femmes tandis qu’elles effeuillent le sorgho. C’est, en fait, un faux chant de travail, dit l’expert : les femmes interrompent leur besogne pour le chanter. Un autre, dit « à répondre », accompagne les travaux de construction. Enfin, un chant des tribus, chant de guerre, est repris par des voix d’enfants.
L’après-midi, conversation avec un archéologue français : « un archéologue doit rêver, dit-il. La rigueur scientifique ne saurait suffire. » Soit ! Je n’ai donc pas la vocation.
Le soir, pendant une longue heure, l’électricité s’absente tandis que gronde l’orage et cingle la pluie. Allongé sur le lit, je jouis du spectacle féerique des éclairs à travers les vitraux colorés de la chambre.











LUNDI 12 JUILLET
SANAA LA VIEILLE
Ce matin, promenade à pied au cœur de la vieille ville de Sanaa. Depuis ma première visite, seize ans ont passé et la cité a embelli : les rues sont désormais pavées et propres. La propreté est une qualité remarquable en un lieu où (c’est l’usage) tout se jette dans la rue car autrefois, toute chose était organique et biodégradable. Les façades des édifices anciens ont retrouvé une nouvelle jeunesse et resplendissent de blancheur. Sans doute, comme l’observe un familier des lieux, a-t-on quelque peu exagéré la dose de gypse dans les ornementations. Elles furent restaurées, elles aussi, dans la perspective de l’avènement de Sanaa au rang de « Capitale culturelle arabe 2004 ». Au pied de certaines de ces maisons fleurissent encore ces jardins, potagers ou vergers, qui contribuent à leur charme. En cette fin de matinée, les rues respirent le calme et, il fait bon flâner sous le ciel bleu qui coiffe la cité.
Prendre du recul et contempler la vieille ville : panorama admirable que ces alignements de constructions, qui, hautes tours, se hissent fièrement vers le ciel tels des gratte-ciel avant la lettre. Construites selon des procédés millénaires, certaines de ces maisons ont affronté plus de quatre siècles. Au nom de quelle « modernité » devrait-on les abandonner ? Elles offrent un riche mélange de styles et de matériaux yéménites : les premiers étages, en pierre sombre de basalte supportent les niveaux supérieurs édifiés en brique. Ces briques en terre brune, séchée au soleil, ont cédé la place, au début des années 90, à leurs semblables de couleur rouge. De complexes frises en gypse blanc ornent généralement les façades. Les fenêtres marient formes arrondies et anguleuses. Depuis les années 90, le verre coloré a remplacé les plaques d’albâtre qui filtraient la lumière ardente du soleil. Le soir, ces vitraux dessinent dans la nuit des motifs de couleur.
Ces maisons s’élèvent jusqu’à cinq ou six étages. Chacun répond à une fonction particulière. Le dernier étage, « chambre avec vue » sur les sommets environnants est toujours le siège du mafraj, salon où, chaque après-midi, on « broute » le qat, moment de plaisir et de sociabilité.
À la mi-journée, à l’hôtel Médina, résidence des musiciens de l’Hadramawat présents à Sanaa, au dernier étage, le Diwan est un immense salon. Ses divans accueillent une bonne centaine de personnes, s’adonnant à cette heure au plaisir du qat. Le sol est jonché de rameaux rejetés qui composent un épais tapis végétal. De temps à autre, l’un des musiciens joue et l’esprit s’évade et vagabonde… Au milieu de quelques dossiers épars, le Ministre de la culture, flanqué d’un secrétaire qate avec application. Peu avant 19 heures, il prend congé et, chacun se lève pour saluer son départ.
Du haut de ce salon, Sanaa s’offre à la vue : minarets élancés et maisons-tours dressés sous la soie bleue du ciel, sertis dans l’écrin des montagnes qui cernent la ville comme autant de joyaux.
Dans une chambre située à l’un des étages inférieurs, le vieux maître Said Abdel Naïm, 90 ans, reçoit, entouré de ses musiciens, le visiteur étranger. Il joue du hajir, tambour à deux faces tenu horizontalement. Le plus souvent, ses mains frappent une seule face. Une gasba et trois mirwas, petit tambour à une face joué d’une main, l’accompagnent. Chaque mirwas marque un temps du rythme qui est donc ainsi divisé. Cette technique et les sonorités qu’elle produit évoquent le gamelan d’Indonésie : en Hadramawt, l’influence indonésienne est fort ancienne, mais on ne sait guère qui a influencé qui. Le vieux maître chante d’une voix légèrement fatiguée et ses musiciens lui répondent. Ils interprètent une mélodie de Sanaa fondue dans leur style, un chant émouvant :
« Si je meurs,
Laissez ma main dépasser avec les instruments
Que, à la fin des temps, je puisse chanter »
Suit un thème dont le final est plus rapide que l’ouverture. Le maître prodigue alors ses conseils à ses percussionnistes. Se saisissant d’un mirwas, il leur montre le tempo… Un véritable atelier musical.
Pour conclure, à nouveau, une chanson de Sanaa, ornée de glissandi à la manière d’Abou Bakr… À la manière de l’Hadramawt ?
Je regagne le diwan. Enseveli au creux d’un divan, j’attends l’ami J. plongé dans « L’hiver de force » de Rejean Ducharme, auteur québécois insoucieux du Yémen… La nuit enténèbre la ville. Les vitraux de maisons se teintent de douces couleurs et les minarets s’illuminent de vert, couleur de l’Islam : vert islam. La nuit sera courte.
MARDI 13 JUILLET
SEYUN, SHIBAM, TARIM
Le réveil se souvient de moi à … 3 heures 30 ! C’est tôt ! À 4 heures, j’attends le véhicule qui me conduira à l’aéroport. La nuit enveloppe encore la ville ; des chiens errent en quête d’une improbable pitance. Entre le faîte de deux hautes demeures dont les vitraux enluminent les ténèbres sourit un croissant de lune. Il fait frais. À cette heure matinale, déjà, des gens se lèvent et s’activent…
Après un survol des sables et des montagnes de l’Hadramawt, l’avion atterrit à Seyun. Il est 8 heures. Le ciel est tendu de bleu et la chaleur brûlante. L’été, le climat est si éprouvant que, dit-on, « même les chameaux se plaignent de la chaleur ! » En revanche, l’hiver est froid.
La route file entre vastes palmeraies, champs cultivés et masses montagneuses. Issues de concrétions de sable, elles sont érodées, creusées, sculptées par les vents… (et les pluies de l’hiver ?)
Situé au pied de ces montagnes, à deux kilomètres de la ville, l’hôtel Samah entoure de ses deux étages un patio fleuri. Affiché à la réception, le règlement intérieur est formel : on est prié d’y laisser… son arme !
Dès 9 heures 30, les amis de J. conduisent le visiteur en voiture à Seyun. Découvrir cette ville de 30 000 habitants tandis que la température dépasse déjà les 40 degrés -une véritable fournaise- ressemble à une épreuve. La cité conserve l’orgueilleux palais de son sultan, l’un des plus pompeux, paraît-il, du sud Yémen. Le guide est explicite : « c’est un colosse de plâtre blanc à plusieurs étages, aux fenêtres décorées de bleu ciel. Il se dresse sur une éminence voisine du vieux souk. Son aspect actuel remonte aux années 20 et 30. » Aujourd’hui, c’est un musée. La section « arts et traditions populaires » offre une initiation aux us et coutumes du pays : naissance et mariage, outils aratoires, vannerie en feuilles de palme, pièces et billets de banque, instruments de musique, médecine arabe… À partir de ces objets, l’esprit imagine le quotidien…
À la mi-journée, Shibam : au centre de la vallée, non loin du fleuve, la ville s’élève sur une légère éminence. Elle compose un ensemble de 500 immeubles environ qui occupent une superficie de 500 mètres carrés. Construits en pisé -mélange de boue et de paille- ils comptent de quatre à sept étages. Véritables « gratte-ciel », ils défient le temps.
Surnommée « la Manhattan du désert », Shibam offre un exemple étonnant d’urbanisme ancien. La plupart des constructions datent du XVI° siècle. Beaucoup ont été reconstruites voici un siècle environ. Les édifices en pisé reposent sur des fondations de pierre et, ils sont coiffés d’une charpente en bois. Le plus haut s’élève jusqu’à trente mètres au-dessus du niveau de la rue. De belles portes, verrouillées grâce à d’ingénieuses serrures en bois gravé, en ferment l’entrée. Des écrans en bois finement sculpté protègent les fenêtres de l’ardeur du soleil et du regard de l’autre. On ne se lasse pas de contempler ces constructions aux façades aveuglées par ces écrans. Art de construire, art de vivre. Raffinement.
Il est aux alentours de midi. Le soleil atteint son zénith. Absence d’arbres, parcimonie de l’ombre en ces ruelles de sable. La température excède les quarante degrés, la chaleur accable. Les chèvres qui gambadent au pied des immeubles semblent s’en accommoder.
Pénétrer dans l’une de ces singulières maisons est instructif. L’ascension des six étages procure une sensation de réconfortante fraîcheur. L’air circule. À chaque étage, un pilier de bois ouvragé et multicolore soutient les plafonds. Tout est pensé : l’eau pour la cuisine et les évacuations et même, la possibilité d’accéder à la maison voisine par le haut, ce qui permet d’éviter de gravir les volées de marches… Point de mobilier ; y en avait-il à l’origine ? L’étage supérieur, bien entendu, est réservé au mafraj.
Sur une petite place resplendit une jolie mosquée toute poudrée de blanc. À l’ombre d’une gargote voisine, un thé hydrate et réconforte. L’eau en bouteille est vendue… congelée !
Au milieu de l’après-midi, sur la route de Tarim, encore et toujours règne une chaleur étouffante. Dans le lointain, le ciel se voile puis, au fil de la trentaine de kilomètres, s’assombrit. Le vent commence à souffler, enfle et emporte en son élan ce sable clair qui s’infiltre partout. De violentes rafales de sable s’abattent sur le véhicule. On ne voit guère au-delà d’un mètre. Et voilà qu’il fait nuit. Conduire est périlleux. Il faut rouler au pas, s’arrêter, poursuivre dans le sillage d’un poids lourd, promu premier de cordée. À Tarim, orage et pluie succèdent à la tempête de sable.
C’est le local d’une association. Dans le diwan, c’est l’heure du qat. Au Yémen, c’est souvent l’heure du qat. Le qat qui paralyse toute activité. Voir les Yéménites mâchonner ainsi, pendant des heures, les feuilles vertes et les tiges les plus tendres laisse songeur : voilà bien des efforts pour un plaisir difficile à mesurer mais qui paraît fort… mesuré. D’autant que ce végétal distille un goût amer qui assèche les muqueuses et suscite la soif. En ce domaine, on peut revendiquer le droit à la paresse.
Lentement, le temps s’écoule dans une indolence générale. Rien n’advient. Enfin, mes demandes réitérées persuadent deux amis d’abandonner la séance de qat -mais, point leur chique calée au creux d’une joue- pour offrir à l’étranger une visite de cette ville de 15 000 habitants, nichée entre hautes falaises rocheuses et palmeraies. Longtemps, elle fût un foyer chaféite* au sein de l’Islam sunnite. Du XVII° au XIX° siècle, elle abritait, dit-on, autant de mosquées que l’année compte de jours. Celles-ci jouèrent un rôle capital en assurant le rayonnement du chaféisme en Hadramawt et à l’extérieur de la province. Construit en pisé, le minaret carré de la mosquée Al-Mudhar s’élève jusqu’à cinquante mètres. Il serait le plus haut de l’Arabie du sud.
Tarim recèle aussi de nombreux palais édifiés entre la fin du XIX° siècle et les années 30. La plupart sont déserts. Un quartier de vingt-trois palais fut construit par la famille Al-Kaf qui avait fait fortune en Extrême Orient. Les « millionnaires de Singapour » ont construit dans un style qualifié de « baroque javanais ». Les influences héritées de l’Asie sont notables dans l’Hadramawt.
Brève escale à la rest-house Qasr al-Qubba, petit palais multicolore serti au cœur d’un bosquet de palmiers. La pluie a cessé de jouer les importuns mais, le ciel fait des caprices et les nuages jouent à cache soleil.
*Cf. plus haut









MERCREDI 14 JUILLET
TARIM, LE DAN
5 heures 30 et déjà la chaleur !
13 heures : manger est une obligation. Ce n’est guère un plaisir tant la chaleur, sèche et accablante, de cette fournaise qu’attise un vent chaud, coupe l’appétit.
En ce début d’après-midi, la tempête de sable d’hier s’est évanouie et, sous un soleil brûlant et desséchant, la route de Tarim, rectiligne, autorise la vitesse.
Dans ce même local de l’association, on trie les feuilles de qat et les mâchoires commencent leur travail. Un noir sert l’eau et le thé, versé très sucré, dans de petits verres. Une vingtaine d’hommes est désormais réunie pour offrir les festivités au visiteur : chants et danses de la tradition hadramawi tout d’abord. Une gasba et deux mirwas escortent les voix de ces chants de mariage et les pas de ces danses alertes et spectaculaires. Il semble que la pose du pied évoque, à l’occasion, certaines traditions d’Indonésie.
Ensuite, les tapis disposés sur la terrasse extérieure accueillent le dan tandis que circule le thé. Cette joute réunit un chanteur, un noir âgé et édenté dont le poids de l’embonpoint s’appuie sur une canne, trois poètes et un scribe. L’un des poètes choisit un sujet et improvise sur ce thème selon des règles strictes de versification. Au fur et à mesure que se développe le flux de l’improvisation, la voix du chanteur s’empare des mots du poète et les chante tandis qu’un troisième complice les couche par écrit. Ainsi se conjuguent oralité et écriture et se conservent les « textes » des improvisations.
A 18 heures 30, le muezzin appelle à la prière. La vie s’arrête. Sur les tapis se succèdent les gestes rituels de dévotion. Au terme de la prière, s’écoule une heure de silence absolu. Ensuite, le dan reprend son cours.
L’un des poètes improvise ; un autre enchaîne mais sur le même thème et ainsi de suite jusqu’à épuisement du sujet. Ainsi s’instaurent de véritables discussions poétiques, chantées et écrites entre les poètes. Aujourd’hui, l’un des thèmes choisis est « la visite de Jacques » et donc, la France, Paris que l’on aimerait tant découvrir car c’est une ville, dit-on, beaucoup plus belle que Berlin…
Feu d’artifices de mots. Et vive le 14 juillet !
Malheureusement, Saleh Boukka, l’un des orfèvres du dan, se trouve actuellement à Sanaa.
Dîner tardif à Seyun : agneau succulent.
JEUDI 15 JUILLET
SEYUN-MUKKALA









La nuit s’achève… à 4 heures 20 !
À 9 heures 05, ce n’est pas le chauffeur attendu qui se présente : il vient de perdre sa mère. On prendra donc la route avec un inconnu : un homme jeune, pistolet enfoncé dans la ceinture…
À cette heure, la température extérieure atteint déjà les quarante degrés. Heureusement, le véhicule est équipé d’un circuit d’air conditionné : au fil des heures, cependant, le thermomètre intérieur oscille entre 28 et 35 degrés. On imagine aisément la vie d’un être dont le moindre geste, comme le moindre pas, coûte un effort sous ce climat délétère.
Direction Shibam ! Dernier regard jeté à cette merveille du génie humain, adaptée à son milieu naturel et au climat ambiant. Pourquoi faut – il que la « modernité » rompe avec la tradition ?
On emprunte ensuite la route 102 et l’on bifurque vers le sud : la route 233 descend jusqu’à Mukkala. On suit d’abord le cours du wadi Hadramawt, le fleuve. Le paysage aligne une suite de montagnes pelées : sommets arasés et pentes éboulées. La terre, d’un bel ocre clair, fertile ici et là, accueille palmeraies, champs de céréales, arbres divers. Les nappes d’eau qui irriguent ces sols gisent à de très grandes profondeurs. Vêtues de noir, des paysannes s’échinent dans les champs tandis que d’autres veillent sur les troupeaux de chèvres. Elles s’abritent du soleil meurtrier en coiffant de larges chapeaux de palmes tressées ; généralement de couleur jaune, ils présentent une forme conique et leur sommet pointe vers le ciel ou bien s’arrondit tel un pain de sucre. Des charrettes tirées par des ânes ahanent jusqu’à l’un de ces villages dont les maisons d’une architecture géométrique, construites en briques de terre séchée, entourent une modeste mosquée.
Au bord de la route, sèchent comme des tranches de terre humide. On les empilera ensuite horizontalement comme des jeux de cartes sous le soleil ardent. Sèches et dures, elles constituent le matériau idéal pour la construction. Oubliés de la croissance, les gens d’ici conservent une antique sagesse ainsi qu’un art de vivre conforme à leurs besoins et en harmonie avec la nature. Pour combien de temps encore ?
Plus loin, le paysage change : le relief s’écrase et apparaît une étendue plate et désertique composée de sable et de cailloux et parsemée de quelques maigres arbustes. Au cœur de ce paysage abandonné, le pneu arrière gauche expire. Sous les brûlures d’un soleil à son zénith (plus de 40 degrés), réparer s’impose…
Au fil du parcours, l’altimètre de la voiture indique divers changement d’altitude. Sans doute des hauts plateaux semi - désertiques nous promènent-ils de leur sommet à leur base… Suit une descente vertigineuse le long d’une route en bon état mais fort sinueuse et, la végétation réapparaît.
Une fois atteint le niveau de la mer, la terre est dépourvue de relief ; à la chaleur sèche succède une éprouvante chaleur humide.
À Mukkala, ville du sud de l’Hadramawt, c’est un hôtel charmant de style vaguement colonial, baigné par ce vent chaud chargé d’humidité. Assis sur un promontoire, il regarde la mer d’Oman et la vieille ville. Perchés dans les arbres et les lauriers – roses des jardins qui l’agrémentent, de drôles d’oiseaux noirs jacassent et leur bavardage, mêlé à la rumeur de la mer, berce les jours des hôtes. Confortables, les chambres sont équipées d’une douche en état de marche, de l’air conditionné et d’un ventilateur. Le personnel est courtois et l’anglais ne lui est pas étranger. C’est un havre de repos au charme désuet.
Au milieu de l’après-midi, un vieux taxi déglingué, pare-brise étoilé et banquettes défoncées, cahote vers Almadina Alkadima, la vieille ville. Le chauffeur, un jeune noir grassouillet, escorte aimablement à pied le visiteur dans les venelles de cette cité. Elles sont encombrées d’immondices et les chèvres s’en délectent. Dans cet univers sale et puant, des ribambelles d’enfants jouent et lancent au passage de l’étranger le traditionnel « hello » ou ses variantes, « what is your name ? « ou « kalam ? » (crayon ?). On distribue donc crayons et stylos bille à ces gosses délurés et beaux comme des anges. Des anges maudits car, pour la plupart, condamnés à la misère.
Voilées, elles arpentent le sable des ruelles ; certaines, sans visage, portent, en outre, un voile qui leur masque leurs yeux : femmes sans visage-femmes sans regard, fantômes qui déambulent dans les rues…
L’architecture offre un désordre cosmopolite, mélange de ruines et d’édifices délabrés et de style arabe et indo – indonésien comme les traits de certains visages qui rappellent aussi l’Asie.
Au bord de la mer, les chèvres encore se régalent des tas d’ordures abandonnées et les enfants se précipitent dans l’eau, certains tout habillés, conformément sans doute à la pudeur musulmane. Certains trottoirs accueillent d’augustes vieillards : ils disputent d’interminables parties de dominos en sirotant leur thé à petites gorgées. Il fait doux à cette heure que parfument les effluves marins charriés par un vent léger. Moment paisible, exempt de torpeur, tandis que le crépuscule prélude au coucher du soleil.
Brève visite au quartier voisin de Hay Alslam, encore plus sale et délabré, qui grignote le flanc de la montagne. Les rues escaladent les pentes ; elles sont le territoire des enfants et des marchands ambulants… On y découvre même un billard !
Incursion dans le souk fort achalandé à cette heure et hanté par des cohortes de voiles noirs. Impubère, un garçonnet vante avec conviction les mérites d’un soutien-gorge à une femme sans visage ! Rire.
Ce soir, c’est l’inauguration de El Badala, festival annuel qui ouvre « la saison verte », celle des dattes et des… baignades. En effet, pendant une dizaine de jours, la température de la mer est plus fraîche, grâce, dit-on, à l’inversion des courants.
Au cours de cette période, le festival se déroule, dit-on, « sur la corniche, au-delà de la médina ». En fait, c’est plus loin, au diable vauvert… À 21 heures, la scène, dressée en plein air, au bord de la mer, n’est pas encore prête : plus d’une heure d’attente debout ! Dure journée. On s’affaire activement pour coller en fond de scène, en haut, un portrait du président Saleh et les couleurs du Yémen. On pratique un essai de synthétiseur : tonitruant ! Des amateurs tirent des feux d’artifices qui expirent avant de fleurir le ciel.
Musiciens et danseurs de tous âges et de styles divers, enfin, se succèdent, porteurs de traditions de la province, plus ou moins respectées, souvent blessées par les frasques du synthétiseur. Ravi, le public, debout ou assis sur des bâches, chante avec les artistes et applaudit volontiers. Beaucoup de monde, une foule, toutes générations confondues. Peu de femmes ; toutes sans visage. À l’exception de la présentatrice, vedette de la télévision, vêtue de blanc et bleu… Les hommes semblent apprécier.
Trois heures plus tard, le concert s’achève : pagaille indescriptible due à l’anarchie de la circulation. La discipline au volant n’est guère une vertu yéménite !
VENDREDI 16 JUILLET
LE CHABWANI DE MUKKALA
Il est 9 heures, les bateaux de pêche regagnent le port.
À midi, des hommes déjeunent dans les jardins ; point de femmes.
En début d’après-midi, quelques minutes de paresse, exposé au soleil, face à la mer, caressé, par le souffle tiède du vent. À cette heure chaude, les enfants, qui d’ordinaire courent en tous sens, se reposent. Leurs cris se sont tus. Seuls ces drôles d’oiseaux noirs bavardent.
Commandé pour 15 heures 45, le taxi arrive à 16 heures 20 ! Inch Allah ! Le Yémen est un pays de patience. Tours et détours pour trouver ce lieu où la musique est promise… Au lieu dit, rien. Le Yémen est un pays riche en surprises ! Au carrefour, le chauffeur embarque un policier qui règle la circulation ! C’est l’un de ses copains. Arrivé au poste de police, il téléphone. Eureka ! C’est à l’orée de la corniche que les festivités se déroulent : au milieu d’une rue, une centaine de danseurs évoluent, armés de cannes de bois, portant futa et turban multicolore. Ils sont flanqués de percussionnistes : mirwas et riqq, deux tambours plats frappés avec des baguettes. Grandiose !
À intervalles réguliers est placé une sorte de maître de cérémonie : il mène la danse et, si besoin est, souffle les paroles.
Cette large formation d’hommes rassemble toutes les générations : de l’adolescent fringant à l’octogénaire édenté. Chaque homme chante comme une lente mélopée, rythmée par les sonorités des percussions. Tous dansent en un parfait ensemble : un pas légèrement sautillant en avant, un pas en arrière, un pas à gauche, un pas à droite, un, deux, trois pas en avant, un, deux, trois pas en arrière, et ainsi de suite… Cannes à l’épaule, cannes levées, cannes croisées, cannes frappant le sol… Quelques mètres en arrière… Ainsi va le chabwani, danse majestueuse, noble et fière. Danse guerrière ? On ne sait, mais, symbole d’identité pour les Hadramites. Émerveillé, on contemple, plus d’une heure durant, ce spectacle qui n’en est pas un, cette beauté surgie d’un autre temps, d’un autre monde. La diversité est richesse.











Retour à pied par la route qui festonne le rivage. Jonchée d’immondices, elle court au pied des immenses réservoirs du port de commerce. Des véhicules frôlent le promeneur dans un concert d’avertisseurs. Plus loin, le chemin s’aventure à proximité des roches et de la mer, et l’on apprécie le calme.
Voiles noirs juchés sur les rochers
Jeunes filles contemplant la mer
Grands oiseaux noirs silencieux.
Comme des pirogues, des dizaines de barques reposent sur l’eau du modeste port de pêche. Quand elles voguent sur la mer, la vitesse du moteur qui les propulse soulève leur proue et leur donne fière allure. Quelques caboteurs aussi croisent dans les parages.
Le soir, il fait bon, la piscine de l’hôtel est assaillie par des nuées d’enfants et d’adultes peu dénudés.
Sur la scène d’El Balda, le spectacle est affligeant d’amateurisme et de médiocrité, le son accablant. Le concert rassemble un maigre public. Assez cependant pour provoquer, à la fin, un véritable chaos dans la circulation. C’est une coutume locale. Les Yéménites se garent n’importe où et n’importe comment, s’arrêtent en plein milieu de la rue, par exemple pour discuter, doublent à droite, klaxonnent sans raison (pour affirmer leur virilité ?). Des kyrielles de motos slaloment parmi les voitures… La police est passive. L’armée aussi. En ce domaine, l’indiscipline des citoyens semble la règle.
SAMEDI 17 JUILLET
MUKKALA-SANAA, L’HEURE EXQUISE
Même le soleil est voilé ! Moiteur.
Ce gentil vieillard est l’homme de ménage de l’hôtel. De petite taille, il est coiffé du traditionnel bonnet blanc et trottine, affairé, de chambre en chambre. Ses grands yeux illuminent un visage buriné qui respire la sérénité. Voire la sagesse. On aime ces visages dont les traits racontent une vie.
C’est le départ. Une fois n’est pas coutume, le taxi s’annonce en avance. Le chauffeur a étudié l’agriculture pendant sept ans à Cuba, il parle espagnol. Ola companero ! Que tal ?
L’avion décolle avec du retard. Cap sur Aden ; 37 degrés à l’ombre ! Et ce n’est pas un film. Longue escale. Les passagers qui embarquent doivent, chacun, reconnaître leurs bagages sur la piste. Certaines valises sont délaissées : certains des passagers doivent redescendre : en fait, des femmes sans visage… Et sans mémoire ? Reste un gros sac. Attente. Sans doute las d’attendre, le préposé fourre le sac dans la soute ! Autrement dit tout ce cirque sécuritaire était inutile ! Ah ! le sud, quel foutoir !
Sanaa. Palabres pour dégoter un taxi… introuvable ! Jovial et sympathique, « Monsieur Sheraton » me dépêche… la limousine de l’hôtel au prix d’un tarif abordable pour un manant étranger. Le temps est incertain. Ici, on respire et la relative fraîcheur est bienvenue. La circulation est, comme d’ordinaire, chaotique et bruyante. Ah ! Le sud… Mais non, ici, pourtant, c’est le nord !
Fin d’après-midi, au domicile du professeur M., se tient la traditionnelle séance de qat, en présence de l’illustre musicien de Sanaa, Hassan Al Ajami, qui chante en s’accompagnant du ûd yéménite. Le salon est comble : jeunes stagiaires arabisant de Normale Sup (tous plus ou moins agrégés de ceci et cela, médiéviste, statisticien-économiste-violoncelliste…), doctorants et chercheurs divers… Filles et garçons, tous réunis. Les uns qatent, les autres pas…
Al Ajami joue en virtuose accompli déployant une rythmique subtile et offrant cette belle voix légèrement nasale. Heure exquise : al tarab, l’extase ! Il pose son instrument et parle car, c’est aussi un causeur. Puis, il joue à nouveau, sans se faire prier, dans un silence absolu et les ténèbres naissantes…
C’est alors l’heure où les muezzin entonnent leur stupéfiante sarabande. Chacun se retire en lui-même. Al Ajami fait silence.
Une heure plus tard, il se saisit de son luth et joue. A l’occasion, il chante aussi a capela. M. sort sa cave… Ainsi se déchire le voile hypocrite de l’abstinence.
Comme chaque nuit, sur le coup de 3 heures 30, le chant trépidant des muezzin envahit le sommeil du juste…
DIMANCHE 18 JUILLET
RETOUR, L’EPREUVE
Ultime conversation avec R.
A diverses reprises, raconte-t-il, il aurait entendu certains Yéménites dire, en le croisant : « Que dieu me préserve de l’infidèle » tout en se bouchant le nez. ! Par ailleurs, il relativise le risque islamiste car, constate-t-il, « là où les islamistes ont exercé le pouvoir, ils n’ont guère fait leurs preuves ». Enfin, il juge « primaires » les missionnaires wahabites avec lesquels il a déjeuné voici quelques jours : « ils prétendent détenir la vérité, les autres seraient tous dans l’erreur ». Mais ces missionnaires considèrent R. comme dangereux car il connaît bien l’Islam et ce ne peut être que dans la perspective de le … détruire !
Sur le chemin de l’aéroport, ultimes embouteillages…
À bord de l’appareil, c’est le bordel habituel : la plupart des passagers ne sait pas lire et s’assoit n’importe où ! Vêtu de sa longue abaia blanche, sandales assorties, et coiffé du traditionnel foulard rouge et blanc, un jeune sheikh, beau comme un coucher de soleil sur les montagnes, attire tous les regards…
Le vol sera long et pénible, truffé d’imprévus… et d’escales d’un émirat à l’autre.
Avec l’aimable autorisation de Jean Lambert, ethnomusicologue spécialiste du Yémen, ancien directeur du Centre Français d’Archéologie et de Sciences Sociales (CEFAS) à Sanaa (Yémen) et, actuellement, à l’Université de Nanterre.